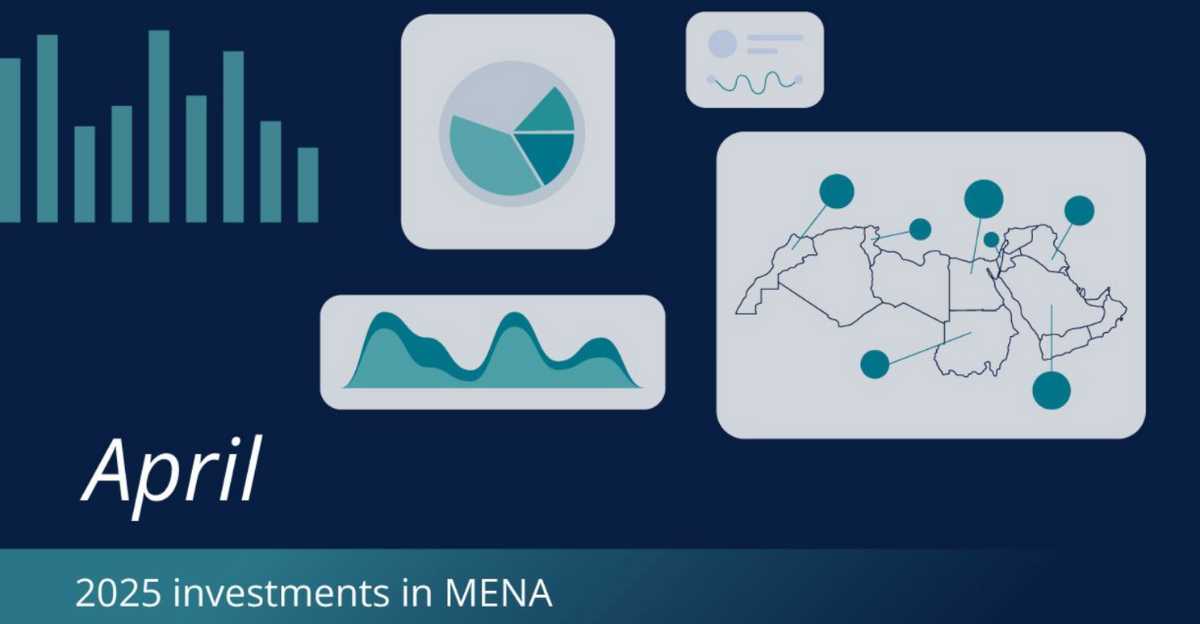Dans de nombreux decks marocains, la « valeur ajoutée » se résume à une liste de bénéfices génériques : rapidité, simplicité, efficacité, innovation. Ces promesses sont trop vagues pour convaincre un investisseur.
Une valeur ajoutée réelle se prouve, elle ne se déclare pas. Elle doit s’ancrer dans un usage concret, un gain mesurable ou une amélioration claire du quotidien ou de l’activité d’un utilisateur.
Les investisseurs marocains qu’ils soient issus de fonds locaux, de réseaux de business angels ou de programmes universitaires écartent rapidement les pitchs qui confondent argumentaire marketing et démonstration rigoureuse.
Comprendre ce que signifie réellement “apporter de la valeur” est donc essentiel pour renforcer la crédibilité d’une startup.
1. La valeur ajoutée est un gain mesurable, pas une promesse
Démontrer la valeur ajoutée revient à répondre à une question simple : qu’est-ce que l’utilisateur gagne grâce à votre solution qu’il ne gagnait pas avant ?
Ce gain doit être mesurable ou observable. Il ne s’agit pas d’une impression ou d’une aspiration, mais d’un bénéfice concret.
Dans l’écosystème marocain, ce gain doit être analysé selon la réalité de la cible :
une PME cherchera une réduction de coût ou de temps,
un commerçant cherchera une simplicité d’usage,
un agriculteur cherchera une meilleure prévisibilité ou accès aux informations,
un client B2C cherchera une solution plus rapide ou plus fiable.
Les investisseurs ne veulent pas savoir ce que la solution “permet potentiellement”. Ils veulent comprendre ce qu’elle change réellement.
Ce changement peut se traduire par :
un processus raccourci,
une tâche automatisée,
une erreur évitée,
un gain de temps,
une réduction de coût,
une augmentation de revenus,
un accès facilité à un service.
Présenter une valeur ajoutée solide ne nécessite pas des chiffres spectaculaires. Un simple test utilisateur ou une preuve d’usage peut suffire.
Mais elle doit être cohérente avec le problème présenté. Une valeur ajoutée qui ne répond pas au problème initial crée une incohérence dans le pitch deck et réduit la crédibilité de l’équipe fondatrice.
La valeur ajoutée est donc la conséquence directe de la solution jamais une extrapolation. Elle doit toujours être formulée en termes opérationnels, pas en termes conceptuels.
2. Comment prouver la valeur ajoutée : tests, preuves, retours terrain
Une valeur ajoutée ne devient crédible que lorsqu’elle repose sur des éléments observables. C’est ce qui fait la différence entre une idée théorique et un projet concret.
Au Maroc, plusieurs types de preuves sont particulièrement appréciés des investisseurs :
1. Les tests utilisateurs
Même un test à petite échelle, réalisé dans une PME locale, dans une coopérative ou auprès d’un groupe pilote dans un incubateur, peut apporter une validation forte.
Le but n’est pas la quantité, mais la pertinence : comprendre comment la solution améliore réellement un usage.
2. Les données tangibles
Quelques chiffres simples peuvent suffire :
réduction du temps d’exécution d’une tâche,
diminution des erreurs,
meilleure rétention des utilisateurs,
adoption plus rapide que prévu,
augmentation du taux de satisfaction.
Ces données doivent être réelles, mesurées et cohérentes avec le stade du projet.
3. Les comparaisons avec les méthodes existantes
Comparer la solution à la manière dont les utilisateurs gèrent actuellement le problème est souvent l’argument le plus puissant.
Au Maroc, dans de nombreux secteurs, les processus sont encore manuels ou non digitalisés. Une solution qui simplifie réellement ces méthodes a un avantage immédiat.
4. Les retours terrain
Un simple témoignage utilisateur reformulé de manière factuelle peut faire la différence.
Exemple : “Avec cet outil, nous avons pu suivre nos ventes sans erreur pendant le mois de test.”
Ce type de preuve est bien plus crédible qu’un discours commercial.
5. Les premiers signaux d’adoption
Même modestes, ils comptent :
premiers clients,
premiers contrats pilotes,
premiers paiements,
demandes entrantes,
inscriptions sur liste d’attente.
Ces signaux montrent que la valeur ajoutée est perçue, pas seulement supposée.
3. Construire la slide valeur ajoutée : simplicité, lisibilité et précision
La slide “Valeur ajoutée” doit être l’une des plus simples et des plus lisibles du deck.
Elle doit éviter les listes longues, les buzzwords, les promesses non mesurables ou les adjectifs génériques.
Une structure efficace se compose généralement de trois blocs :
le bénéfice principal,
deux ou trois preuves courtes,
un visuel simple ou un chiffre clé.
Cette organisation permet à l’investisseur de saisir immédiatement l’essentiel.
Pour le marché marocain, cette slide doit aussi être adaptée à la réalité locale :
éviter les bénéfices inspirés de marchés très développés,
privilégier les améliorations basées sur les usages réels,
rester cohérent avec les comportements d’adoption,
tenir compte de la vitesse de décision souvent plus lente dans certains segments.
Une erreur fréquente est de vouloir multiplier les bénéfices.
Une startup early-stage doit se concentrer sur un bénéfice central, celui qui résume l’impact principal de la solution.
Les bénéfices secondaires peuvent être mentionnés, mais ne doivent pas prendre le dessus.
Les visuels jouent également un rôle clé. Un schéma simple montrant la transformation avant/après permet à l’investisseur de visualiser la valeur créée.
Un bon visuel vaut souvent plus qu’un argument verbal.
La valeur ajoutée ne s’invente pas : elle se mesure et se démontre. Elle repose sur la réalité du terrain, pas sur une ambition théorique. Les investisseurs marocains cherchent des preuves, même petites, mais réelles. Une slide valeur ajoutée bien construite montre que le fondateur comprend son marché et sait montrer l’impact concret de sa solution. C’est l’une des bases les plus solides pour instaurer la confiance.

![[LIVRE] Marcel Planellas et Anna Muni : structurer la pensée stratégique dans un monde incertain l Start-up.ma](https://www.start-up.ma/wp-content/uploads/2025/10/LIVRE-Marcel-Planellas-et-Anna-Muni-structurer-la-pensée-stratégique-dans-un-monde-incertain-1.png)